20 ans après le plan de désengagement, Israël se trouve à nouveau confronté à la question des colonies et de la sécurité du pays.

Il y a vingt ans, entre le 15 août et le 12 septembre 2005, le gouvernement israélien a démantelé environ 21 colonies juives dans la bande de Gaza, déplaçant de force près de 9 000 résidents, dans le cadre d'une décision unilatérale appelée "désengagement" (HaHitnatkut).
Le plan a été présenté par le Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, qui avait la réputation bien méritée d'être un soldat dur et bourru, prêt à repousser les limites pour obtenir des résultats, ce qui lui a valu le surnom de "bulldozer".
Membre fondateur du Likoud, Sharon a remplacé Benjamin Netanyahou à la tête du parti après la démission de ce dernier en 1999. Considéré comme un champion du mouvement des colons, Sharon a remporté le poste de premier ministre en 2001 après avoir fait campagne sur un programme visant à accroître les activités de colonisation, même à Gaza.
Lorsque le Hamas a commencé à lancer ses premières roquettes rudimentaires en 2002, généralement en direction des colonies juives de la bande de Gaza, le mouvement des colons a critiqué Sharon en déclarant : "Si les roquettes tombaient sur Tel-Aviv, Israël riposterait !
Sharon a répondu par une déclaration célèbre : "La règle pour Netzarim [l'une des colonies israéliennes du centre de Gaza] est la même que pour Tel-Aviv !"
Cependant, quelques mois plus tard, Sharon a fait une annonce qui a choqué les colons, déclarant qu'Israël se désengagerait unilatéralement de Gaza.
Mais que faisaient les Juifs à Gaza au départ ?
L'histoire des Juifs à Gaza avant Gush Katif
L'histoire de la présence hébraïque et juive à Gaza remonte à la plus ancienne source écrite sur Israël, la Bible. Dans la Genèse, Abraham et son fils Isaac auraient vécu à Guérar, situé dans l'actuelle bande de Gaza.
À l'époque hasmonéenne, Simon Maccabée fonda une implantation juive à Gaza, comme le décrit le livre extra-biblique 1 Maccabées 13:43-48, un événement également mentionné par l'historien juif Flavius Josèphe. Par la suite, la ville changea plusieurs fois de mains entre l'Égypte, des dirigeants juifs tels qu'Hérode le Grand et le gouverneur syrien.
Au cours de la période mishnaïque, à la fin du IIe siècle après J.-C., une importante communauté juive s'est installée à Gaza et s'y est maintenue tout au long de la période byzantine. La ville est devenue une étape importante pour les Juifs souhaitant se rendre à Jérusalem depuis le pourtour méditerranéen. Cette présence s'est poursuivie même après la conquête arabe au VIIe siècle. Si l'une des synagogues de Gaza a été détruite pendant les combats, les archives historiques continuent de mentionner la présence d'une importante communauté juive à Gaza.
En fait, la présence juive s'est maintenue à Gaza jusqu'à la Première Guerre mondiale, lorsque les Juifs de Gaza ont été déportés en 1915.
Un petit groupe de Juifs tenta de retourner à Gaza après la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, le pogrom arabe de 1929, au cours duquel 69 Juifs furent tués dans les rues d'Hébron, conduisit à une tentative similaire de la part des Arabes de Gaza. Avec l'aide des forces britanniques, les Juifs de Gaza furent à nouveau évacués. De 1929 jusqu'à la guerre des Six Jours en 1967, il n'y eut aucune implantation juive à Gaza.
En 1970, la situation a changé lorsque le gouvernement israélien, sous la direction de Golda Meir, a décidé de créer les communautés de Netzarim et de Kfar Darom, marquant le début de l'établissement des communautés de Gush Katif. Celles-ci étaient dispersées dans toute la bande de Gaza et comptaient 21 communautés distinctes en 2005, lorsque le plan de désengagement a été mis en œuvre et que le projet vieux de 35 ans a pris fin.
Qu'est-ce qui a conduit au désengagement ?
Si l'implantation juive à Gaza est un fait historique et si le Premier Ministre Ariel Sharon était un fervent partisan de l'entreprise d'implantation, qu'est-ce qui l'a poussé à changer d'avis de manière aussi radicale et énergique ?
À cette époque, Israël était engagé dans un processus de paix appelé « Feuille de route pour la paix au Proche-Orient », supervisé par les États-Unis, l'Union européenne, les Nations unies et la Russie, qui visait à mettre en place la « solution à deux États ».
Dans le cadre de cette feuille de route, les parties palestiniennes devaient « s'engager à cesser immédiatement et sans condition toute violence » et à mener « une réforme politique globale », tandis qu'Israël devait soutenir la normalisation de la vie palestinienne en Cisjordanie.
Lorsqu'il est devenu évident que les Palestiniens ne tentaient même pas de mettre fin à la deuxième Intifada en cours, ni même de prendre des mesures pour mettre fin à l'incitation à la haine contre les Juifs et les dirigeants israéliens dans la presse et les publications officielles de l'Autorité palestinienne, le Premier Ministre Sharon a décidé de prendre des mesures unilatérales qui, selon lui, garantiraient la sécurité des civils israéliens.
Sharon avait déjà approuvé la construction de la barrière de sécurité en 2002, à la suite du massacre meurtrier de la veille de la Pâque juive, au cours duquel des kamikazes avaient pénétré dans le Park Hotel de Netanya, tuant 30 personnes et en blessant 140 autres.
Dans un discours prononcé en décembre 2004, Sharon a expliqué son raisonnement en déclarant : « Le concept qui sous-tend ce plan est que seule la sécurité mènera à la paix. » Cette déclaration représentait un rejet de sa façon de penser antérieure, selon laquelle la présence des implantations réduisait la violence palestinienne.
Tout en reconnaissant que les Palestiniens n'avaient pas « rempli leurs obligations » au titre de la Feuille de route, Sharon a promis qu'Israël respecterait les siennes. Il a promis au peuple israélien que le désengagement conduirait à une réduction des attentats terroristes.
« L'objectif du « plan de désengagement » est de réduire autant que possible le terrorisme et d'accorder aux citoyens israéliens le niveau de sécurité maximal. Le processus de désengagement conduira à une amélioration de la qualité de vie et contribuera à renforcer l'économie israélienne », a déclaré Sharon. Le Premier Ministre a même promis que le désengagement, associé à la barrière de sécurité, permettrait à l'armée israélienne de sécuriser plus facilement les frontières d'Israël.
Il a également reconnu que cette mesure était prise afin de « ne pas nuire à notre coordination stratégique avec les États-Unis », qui faisaient pression sur Israël au sujet de la question des implantations, estimant qu'elles constituaient un obstacle à la paix.
La réaction en Israël
L'annonce de Sharon a mis en évidence de profondes divisions en Israël sur la question des implantations et sur la meilleure façon d'assurer la sécurité.
Beaucoup, à gauche, considéraient les implantations à Gaza et en Cisjordanie comme des obstacles majeurs à la paix. Certains, au centre, estimaient que les tentatives visant à protéger les 8 800 colons juifs de Gush Katif contre plus d'un million de Palestiniens à Gaza n'avaient tout simplement aucun sens sur le plan politique ou économique.
À droite, en particulier au sein du Likoud, le parti de Sharon, les divisions étaient également profondes. Benjamin Netanyahu, qui s'était engagé dans diverses querelles publiques avec Sharon afin de reprendre le contrôle du parti, critiquait ouvertement le plan et promettait de voter contre.
Parmi les communautés de colons, on estimait que malgré le risque pour les Juifs dans les implantations, leur présence servait de tampon contre l'agression palestinienne. Ils pensaient également que le désengagement allait à l'encontre des principes du sionisme, qui considérait le retour des Juifs sur l'ensemble du territoire d'Israël comme un droit juif. Ils ont averti que le démantèlement de Gush Katif conduirait à la fermeture d'autres implantations, notamment en Judée-Samarie.
Le plan de désengagement a donné lieu à d'énormes manifestations en Israël, opposant les partisans du plan, qui portaient souvent des vêtements bleus et des rubans bleus, et les opposants, qui portaient des vêtements orange. Les manifestations ont donné lieu à des scènes très chargées en émotion, en particulier lorsque l'évacuation forcée des communautés de Gush Katif a commencé.
Cependant, malgré sa promesse de mener l'opposition au plan de désengagement, lorsque la Knesset a procédé au vote, Netanyahu, ainsi que plusieurs autres politiciens sionistes de droite, ont voté en faveur du plan.
L'expulsion de Gaza
Les personnes évacuées, souvent découragées d'être chassées de leurs maisons, ont scandé des slogans tels que « Un Juif n'expulse pas un Juif ».

Certains habitants de Gush Katif qui avaient servi dans l'armée ont averti, de manière prophétique, que le résultat final ne serait pas une plus grande sécurité, mais davantage de violence.
« Un million de meurtriers vont entrer par le corridor de Philadelphie ! Des roquettes Katyusha sur Ashkelon ! Des mortiers sur Sderot ! Des meurtres à Netivot », a déclaré un réserviste religieux alors qu'il était emmené par d'autres soldats. « Vous êtes tous complices de ce crime, et cela ne servira à rien ! »
L'expulsion, qui s'est déroulée sur plusieurs semaines au cours de l'été 2005, a entraîné un profond sentiment de méfiance au sein du mouvement des colons, qui bénéficiait encore quelques mois auparavant du soutien tacite d'une large partie des politiciens israéliens de centre et de droite. L'absence d'indemnisation adéquate des familles dont toute la vie et souvent les moyens de subsistance ont été brusquement bouleversés a porté un nouveau coup à ces dernières et a renforcé la méfiance envers le gouvernement et le système judiciaire au sein du mouvement des colons. Les conséquences se font encore sentir aujourd'hui.
L'échec de l'expulsion - La montée en puissance du Hamas
Cependant, l'échec du plan de désengagement n'est pas le fruit de 20 années d'évolution. Moins de deux ans après l'évacuation forcée des familles juives de Gush Katif par les troupes israéliennes et l'abandon des développements agricoles qui représentaient près de 40 % de la production agricole d'Israël, la bande de Gaza n'était pas devenue un micro-État palestinien prospère dirigé par une Autorité palestinienne prête à assumer ses responsabilités en vertu des accords d'Oslo et de la feuille de route.
Au contraire, en l'espace de deux ans, à la suite d'une guerre civile brutale, le Hamas a pris le contrôle de Gaza à l'Autorité palestinienne et a commencé à imposer un gouvernement aligné sur les intérêts de l'organisation terroriste.
Le Hamas, qui jusqu'alors n'avait fonctionné que comme une organisation terroriste, est soudainement devenu un organe gouvernemental, avec des sources de financement élargies, la capacité de prélever des impôts et le développement de nouvelles sources de revenus. Cette transformation a permis la création d'une armée permanente composée de compagnies, de bataillons, de brigades et d'un système complet de commandement et de contrôle, le tout situé à quelques minutes seulement de la frontière sud d'Israël.
En l'espace de trois ans, Israël a mené sa première guerre contre le Hamas à Gaza, tout en essayant de maintenir sa « force de dissuasion ». Au cours des 18 années qui ont suivi, Israël s'est retrouvé engagé dans une succession d'opérations contre un ennemi de plus en plus bien armé et préparé à Gaza, la dissuasion s'étant révélée être un concept difficile à mettre en œuvre.
L'échec de cette politique, appelée « La Conception » en Israël, est devenu violent et douloureusement évident le 7 octobre 2023, lorsque les pires prédictions de ceux qui avaient été expulsés de Gaza sont soudainement devenues une horrible réalité sanglante.
Ariel Sharon avait promis un avenir radieux à Israël, tout en mettant en garde contre la capacité de son pays à répondre au feu par le feu.
« Le plan de désengagement unilatéral est la réponse israélienne à cette réalité [d'insécurité] », avait déclaré Sharon. « Ce plan est bon pour Israël dans tous les scénarios futurs. L'armée israélienne se réorganisera à l'intérieur des frontières défensives derrière la barrière de sécurité. »
« Le monde attend la réponse palestinienne, une main tendue pour la paix ou le feu de la terreur », avait-il poursuivi. « À la main tendue [en signe de paix], nous répondrons par des branches d'olivier. Mais au feu, nous répondrons par un feu plus intense que jamais. »
Les 22 derniers mois de guerre ont donné raison à Sharon, du moins sur la dernière partie de sa promesse.
La réinstallation de Gaza ?
À l'approche du 20e anniversaire de l'expulsion de Gush Katif et de la fin possible de la guerre de Gaza, la nation israélienne se trouve confrontée à un ensemble de conditions similaires : un manque de sécurité locale, l'absence apparente d'un partenaire palestinien disposé à faire la paix et la résurgence du mouvement des colons.
Depuis le début de la guerre des « Épées de fer » du 7 octobre, des groupes de colons ont exigé que le gouvernement élabore un plan de réinstallation de Gaza après la guerre. Si le Premier Ministre Benjamin Netanyahu s'est toujours opposé à cette idée, nombreux sont ceux qui, au sein de sa coalition, y sont favorables.
Un élément essentiel a toutefois changé : le paysage politique du Moyen-Orient au sens large. Suite à l'affaiblissement de la stratégie proxy de l'Iran contre l'État hébreu et aux importantes victoires militaires d'Israël lors de la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, de nombreux Israéliens se sentent plus confiants dans la capacité de leur pays à garantir à nouveau sa sécurité.
Reste à voir si cela conduira à une réinstallation de Gaza ou à une volonté d'autoriser prudemment une tentative internationale de reconstruction d'une Gaza sans Hamas.

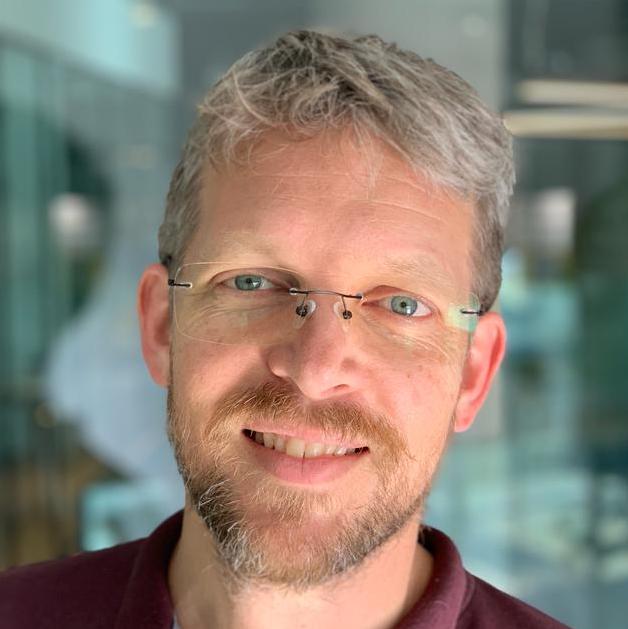
J. Micah Hancock est actuellement étudiant en master à l'Université hébraïque, où il prépare un diplôme en histoire juive. Auparavant, il a étudié les études bibliques et le journalisme dans le cadre de sa licence aux États-Unis. Il a rejoint All Israel News en tant que reporter en 2022 et vit actuellement près de Jérusalem avec sa femme et ses enfants.







