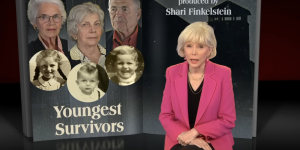Les conséquences de la déshumanisation numérique à l'encontre des Juifs
Quand les hashtags créent un climat… et que ce climat se cherche une cible

Que se produit-il lorsqu'un slogan accumule des coordonnées ?
Sur les plateformes qui imitent l'espace civique tout en rejetant la retenue civique, les Juifs sont remodelés en tant qu'expositions standard : arrangeurs, intrigants, mains cachées. Les vieilles calomnies reviennent avec des polices plus fraîches. Un ricanement devient une tuile partageable, l'ironie fournit un vernis mince et l'ovation contrefaite des likes fournit un verdict sans procès. La répétition passe pour une corroboration ; le bruit se fait passer pour une nouvelle. Dans cette atmosphère, une personne est traitée comme un emblème, et les emblèmes invitent à être manipulés.
La méthode est plus régulière que subtile. Le contexte est éliminé jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une « essence » présélectionnée, obligeamment similaire aux favorites des pamphlétaires. Une citation tronquée est traitée comme une preuve, une photographie comme un aveu. « Poser simplement des questions » arrive comme une enquête, mais fonctionne comme un catéchisme. Les utilisateurs timides empruntent leur audace à la lueur de l'écran et à la sécurité du nombre. À chaque écho, le prix du prochain écho diminue, et ce qui devrait susciter la honte revient sous le titre de la mode.
Les hashtags, vendus comme une participation, fonctionnent comme un acheminement. Ils rassemblent les passionnés, étiquettent la proie et, sous le couvert de la « information publique », publient la piste. Une synagogue devient un repère sur une carte. Une association étudiante est promue au rang de « façade », puis répertoriée avec le bâtiment et la salle. Un petit café acquiert une dimension géopolitique grâce à son menu. La chorégraphie est fiable : un clip monté pour susciter l'indignation, une légende qui dépeint une rue comme un territoire ennemi, un lieu et une heure qui s'annoncent d'une manière ou d'une autre. Le discours se transforme en logistique.
Le langage arrive pré-assaini. Purification, pureté, résistance, justice : de l'encens brûlé sous une vieille bile. Une brique lancée à travers une fenêtre est présentée comme une expression. Une insulte hurlée à une famille en route pour la prière se présente comme une responsabilité. L'euphémisme blanchit les motivations ; la conscience s'éloigne dans des vêtements immaculés tandis que le balai fait son travail sur le trottoir. Ce n'est pas un débat, mais du charlatanisme avec des accessoires.
La permission circule par insinuation. Une allusion historique est poncée jusqu'à devenir venimeuse. Une phrase tronquée est lancée à ceux qui savent quand hocher la tête et quand montrer les dents. Rien n'est explicite, tout est compris. Une rumeur sur une collecte de fonds locale est soudée à une conspiration planétaire et fournie avec un code postal. Aucun leadership n'est nécessaire. Le climat donne les instructions plus efficacement que n'importe quel gouverneur.
Le jugement apparaît ailleurs, et plus tard. Il est écrit dans des modifications mineures apportées à des jours ordinaires. Une mezuzah est retirée et placée dans un tiroir. Une étoile de David est tournée vers l'intérieur sur sa chaîne. Les parents modifient leur trajet pour éviter le coin où des slogans sont scandés au mégaphone. Le hall d'une bibliothèque devient un lieu d'accusations. Les centres communautaires passent des livres et de la musique aux volets et aux caméras. Ce ne sont pas des tendances, mais des détours.
Un récit discret porte sur l'éducation antérieure : l'effacement de soi. Des voix plus basses. Des festivals discrets. Des rues secondaires au crépuscule. L'Europe a autrefois enseigné ces leçons à coups de règlements et de matraques ; l'édition numérique est automatisée et omniprésente, son autorité empruntée à une présence constante. La déshumanisation ne nécessite ni podium ni censure ; un algorithme suffit, aidé par un public qui confond la chaleur avec la lumière et la rancœur avec le sérieux.
Une fois installé, l'emblème devient un problème ; le problème, rendu portable par sa conception et son calendrier, devient une cible. Le théâtre est monté comme une vertu civique. Les applaudissements vont à la troupe ; la facture arrive à la famille la plus proche, vêtue de manière reconnaissable. L'affirmation selon laquelle il ne s'agit « que de paroles » échoue au contact du trottoir. Le discours cesse d'être seulement un discours lorsqu'il mentionne une porte, une heure, un nom. Les mêmes outils qui vendent des baskets le mardi rassemblent une foule le vendredi. Le résultat est un théâtre de menaces présenté comme une participation.
À la fin du week-end, la ville avoue son changement. Un café qui résonnait autrefois de conversations acquiert un calme anxieux. Une école prolonge son briefing sur la sécurité après la sonnerie. Le trajet du vendredi pour rentrer chez soi est raccourci de quelques pâtés de maisons parcourus avec prudence. Les plateformes mesurent les impressions et déclarent que le monde s'est exprimé. Ce qui n'est pas mesurable, ce sont les distances ajoutées aux trajets quotidiens, les voix tendues, les symboles détachés qui retournent dans les tiroirs. Le passage du hashtag au crime haineux n'a rien de mystérieux. Il s'agit de la réification progressive d'un peuple en un emblème, puis en un cas, et du cas en une cible, avec le calendrier fourni poliment par le fil d'actualité.

Ab Boskany is Australian poet and writer from a Kurdish Jewish background born in Kurdistan (northern Iraq). His work explores exile, memory, and identity, weaving Jewish and Kurdish histories into fiction, poetry, and essays.